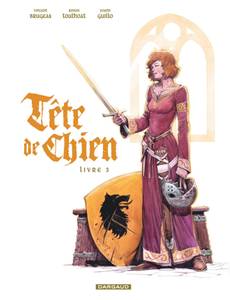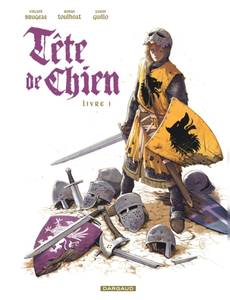Si vous n’êtes pas encore familier avec les chevaliers sans le sous de Tête de chien, on vous laisse vous équiper en lisant notre coup de cœur ici, vous laissant le temps de vous familiariser avec les personnages & l’univers développé par Vincent Brugeas, Ronan Toulhoat & Yoann Guillo.

Et une fois prêt.e.s découvrez la série avec nous. Pour en parler, j’ai invité Marie Kergoat, une chercheuse qui travaille sur l’escrime et la représentation de son patrimoine dans la fiction de fantasy. Cette doctorante est également membre du collège de l’association Le Laboratoire des Imaginaires et éducatrice fédérale d’escrime artistique, le profil idéal pour se balader entre les tentes des jouteur.teuse.s et commenter les combats, les blasons des chevalier.ère.s et cette représentation de l’univers médiéval en bande dessinée.
Comment tu vois la série Tête de chien, avec son intrigue bâtie autour des joutes et des combats, vu que tu travailles sur ce sujet ?
Marie Kergoat : C’est une série intéressante parce qu’elle cherche à dépeindre un élément très connu et très fantasmé du patrimoine médiéval ainsi que de la médiévalité, mais qui est peu traitée dans les faits —en tout cas en bande dessinée.
Il y a des recherches, il y a plein de spécialistes en France qui font de l’archéologie expérimentale ou qui ont “simplement” travaillé sur la question du combat en tournoi : mais la représentation spécifique du rite, de la tradition, du patrimoine, du tournoi, de tout ce qu’il y a autour —avec un aspect sourcé, qui prend en compte les récentes découvertes historiographiques — ça n’a pas encore vraiment été réalisé.
On a en tête des exemples de films qui parlent de tournoi, comme Chevalier qui est notamment connu via Heath Ledger (qui avait joué le Joker chez Nolan) et qui est un très bon film d’ailleurs, mais cela remonte et on a besoin de nouvelles oeuvres pour traiter le sujet en accord avec les recherches récentes Cela permet de mettre à jour l’imaginaire qu’on a du tournoi, en revenant sur des choses qui n’ont pas forcément été transmises en fiction jusqu’ici, mais qui correspondent à l’actualité de la recherche historiographique.
Est-ce qu’il y a justement des points précis auxquels tu penses dans cette série ?
M. K. : La question du tournoi comme gagne-pain. Et pas un simple événement très fantasmé où les divers chevaliers venaient se présenter en l’honneur de quelqu’un Dans Tête de chien on se montre en tournoi pour assurer son statut social, pour l’améliorer et aussi pour se faire de l’argent. Parce qu’il y a la question des nobles désargentés ou des personnes qui souhaitent justement acquérir des titres supplémentaires ou qui doivent des choses à leur suzerain — on voit ça dans le T3 notamment.
C’est très intéressant de proposer cette vision-là du tournoi, qui n’est pas seulement un fantasme de monstration, de rite social, mais aussi une pratique sportive avec des enjeux d’argent. Il y a aussi le lien social autour des rivalités : les rivalités politiques sont au second plan, mais elles restent très explicites parce que tout le monde voit pourquoi le tournoi est organisé, pourquoi ce camp-là est désavantagé, etc. Ça montre que le tournoi peut être un état des lieux de la politique ainsi que du rapport entre les différents suzerains et leurs serfs ou les seigneurs.
Sur le côté contemporain, il y a plein d’indices : les pages introspectives très pop en têtes de chapitre aussi donnent bien cette idée de clin d’œil aux lecteurices…

M. K. : Au niveau graphique, c’est clair ! On est sur une bande dessinée qui se veut de grande diffusion, qui souhaite toucher un grand public, dans le graphisme, dans la façon dont les personnages sont dépeints… c’est complètement dans un style contemporain.
Et les prologues sont aussi là pour mettre l’accent sur les points forts de cette bande dessinée que sont les personnages, ce qu’ils cachent, ce qu’ils recèlent et ce qu’ils vont dévoiler au fur et à mesure.
Ce n’est pas tant l’enjeu de qui va gagner le tournoi ou de l’intrigue politique qui prévaut : c’est un prétexte pour voir les personnages évoluer. Cela témoigne de la volonté des auteurs, je pense, et en même temps, ça fait très série chorale.
Il y a une volonté très pop dans le choix des couleurs, avec un côté très comics pour ensuite repasser sur un dessin plus classique, franco-belge. Et ça, ça va avec les inspirations de Ronan Toulhoat qui se fait un petit kiff. Ça permet d’avoir un clair distinguo entre l’histoire et l’introspection.
Tu pratiques toi-même l’escrime scénique dans une troupe bénévole, comment on se documente et on rend les combats crédibles dans la fiction ? Tu peux nous parler de l’ethnoscénologie que tu as mentionnée dans ton parcours ?
M. K. : L’ethnoscénologie, c’est une discipline qui est née il y a pile 30 ans dans une université parisienne, Paris VIII, à l’initiative d’un enseignant, Jean-Marie Pradier. Et l’idée est de changer le regard dans le cadre des études sur le spectacle : ne plus regarder en tant que personne qui observe, en tant que personne qui voit, mais réfléchir et observer depuis la pratique.

Elle permet de voir l’art de l’intérieur et de discuter avec les personnes qui pratiquent l’art pour sortir de ce regard externe qui recherche, qui regarde de loin en prenant des notes. Déjà, ça biaise complètement la façon d’interpréter l’art. Ensuite ça avait été écrit à la base dans une perspective décoloniale du regard artistique. Autrement dit, plutôt que de regarder ça comme des rituels de personnes qui sont différentes de nous, c’est aller pratiquer avec elles pour comprendre pourquoi, comment, qu’est-ce que ça fait exactement ? Et ça s’est étendu à une forme d’anthropologie du spectacle vivant où on pratique l’art, en général, pour mieux le comprendre et le saisir de l’intérieur : côtoyer les personnes qui font l’art, en somme.
Moi, je pratiquais déjà l’escrime artistique et historique avant de commencer ma thèse, donc c’était tout trouvé. Il y a aussi, bien sûr, ces cas de personnes qui font de l’ethnoscénologie parce qu’elles travaillent sur leur art, qu’elles pratiquent depuis longtemps. C’est le mien, par exemple. D’autres se lancent dans un art après avoir décidé d’y consacrer leurs recherches.
Je fais de l’escrime artistique et de spectacle depuis 8 ans, mais je fais aussi de l’escrime historique qu’on appelle des AMHE : des arts martiaux historiques européens. Qui est une forme littéralement bâtarde entre un sport d’escrime et une espèce de laboratoire d’archéologie expérimentale autour des sources historiques. Je dis que c’est bâtard, parce que selon les clubs, il va y avoir les deux postures ou une seule. Il y en a qui vont être très « on se pose, on lit la source, on lit le traité, puis on expérimente en même temps » et d’autres qui sont mode « ok, il y a le tournoi ou la compèt’ qui est prévue dans cette ville à telle période, donc on s’entraîne pour celle-là ». Et il y en a qui sont un peu les deux, qui pratiquent la partie opposition, avec protections, en mode jeu. Et avant ou après ça, ils étudient les traités, ils font des exercices techniques à partir de l’interprétation des sources.

Je me renseigne ainsi par la pratique de cette discipline. Par des stages aussi, parce qu’on a la chance d’être dans une discipline qui a été vite été très riche en France par des historiens, qui étaient doctorants à l’époque, en histoire médiévale qui ont commencé à travailler sur ces traités-là parce que la recherche n’était pas tout à fait cohérente par rapport aux sources ou traces archéologiques qu’on avait. On disait que les épées étaient super lourdes, pas maniables, mais ça ne semblait pas correspondre à ce qu’on avait comme traces. Du coup, ils ont expérimenté par le corps —quelque part, c’est une forme d’ethnoscénologie de l’histoire, de l’archéologie expérimentale— et c’est eux qui ont mis à jour cette historiographie-là.
Parmi ces personnes, je pense à Fabrice Cognot qui, pour mieux comprendre comment sont faites les épées, s’est dit « je vais devenir forgeron » pour comprendre comment c’était fait, à partir des sources qu’il avait. À Pierre-Henry Bas, Pierre-Alexandre Chaize ou Gilles Martinez qui, lui, travaille sur la représentation du combat féodal —donc milieu du Moyen Âge, à peu près— pour voir l’escrime des tournois : ils avaient quoi comme épées ? Comment s’entraînait un chevalier ? Il y a aussi Nathanaël Dos Reis (doctorant), qui travaille spécifiquement sur l’équipement du chevalier entre le 11e et le 13e siècles.
En fait, c’est une posture qui commence à être assez courante chez les personnes qui étudient l’art martial historique européen : de se pencher sur la pratique pour mieux analyser les sources à disposition. Du coup, je me nourris en discutant avec ces gens-là, en les rencontrant, en regardant des vidéos aussi… et en étant en salle d’armes, tout simplement.
Côté représentation justement, la série adopte certains codes ou motifs du médiéval-fantastique pour embarquer plus vite : le fait d’avoir des étapes classiques (le combat, l’auberge, le bivouac) ou le fait que les personnages acceptent immédiatement que Jehan à un secret et embarquent….

M. K. : C’est vrai, mais je n’avais pas forcément vu comme ça, mais c’est peut-être parce que je lis beaucoup de fantasy.
Il y a vraiment quelque chose d’important quand la fantasy s’intéresse à la question médiévale : ça va être qu’elle véhicule des imaginaires, qu’elle va mettre en avant un certain médiévalisme —le médiévalisme, c’est la question des représentations et imaginaires du Moyen âge, ce n’est pas le médiévisme qui est l’étude du Moyen âge, le médiévalisme c’est l’étude de ces représentations.
Et c’est très intéressant parce qu’en fait, la fantasy, elle est née —en partie, parce que c’est plus compliqué que ça— avec la question de la représentation médiévaliste : ces récits s’inspiraient de romans de chevalerie authentiquement médiévaux, qui mettent en avant ces codes que tu évoques.
Je pense que la question de la chevaleresse, comme un fait qui pose pas question au début, c’est aussi la traduction directe d’un fait historique et social qui est en train de se produire : on se rend compte qu’en fait, il y avait des femmes chevaleresses —bien moins nombreuses bien évidemment, au niveau statistique — travesties pour diverses raisons, ou clamant haut et fort leur genre féminin (c’était aussi un fait bien plus accepté au début de la féodalité.
On a des personnages historiques très connus comme Jeanne d’Arc, mais aussi Agnes Hotot connue pour sa victoire en tournoi, ou Joanna de Montfort qui combattit en armure pour défendre la ville d’Hennebont. On a ainsi des exemples connus, historiques, et d’autres moins. On suspecte également qu’il nous reste nombre de chevaleresses à identifier.

Je pense aussi à un traité du moyen âge qui s’appelle le Royal Armouries Ms. I.33, qui est un traité d’escrime médiévale dont l’origine est possiblement allemande, daté entre le treizième et le quatorzième siècle. C’est le premier livre de combat dont on ait trace concernant l’escrime européenne. Et là-dedans on a une femme qui se bat, qui s’appelle Walpurgis. On a une représentation claire d’une femme qui se bat avec les autres clercs représentés. Pourquoi ? On a aucune info, on a que des hypothèses — pour l’instant..
La fantasy nous a habitués aux personnages de guerrières et on se rend compte que ce n’était peut-être pas tant une invention de la fantasy. C’est juste qu’elle les popularise, qu’elle les normalise, mais la médiévalité avait déjà ces personnages-là. On a trace aussi, dans les romans de chevalerie, d’une chevalière qui s’appelle Silence ( dans un roman en vers du XIIIe siècle intitulé Le roman de Silence par Heldris de Cornouailles), mais on ne la connaît pas très bien, il y a beaucoup de mystère autour — du moins jusqu’ici, encore une fois.
Jehan est le personnage clef, son surnom donne le titre à la série, mais finalement si on accepte son secret c’est que tout le monde à un secret, c’est un des sous-textes de la série…

M. K. : C’est ça, il y a une forme de normalisation de son secret, de ce qu’elle cache. Le fait que tout le monde joute le visage masqué, c’est très intéressant parce que cela crée une variation par rapport aux autres œuvres qui emploient cet archétype, et où le genre de l’héroïne est le grand secret de l’œuvre. Ici, le fait qu’elle soit avec des personnes qui doivent, elles aussi, dissimuler leur identité pour d’autres raisons, normalise la chose.
Ainsi, l’oeuvre ne traite pas seulement du personnage féminin qui se travestit en homme pour pouvoir combattre, il y a d’autres choses autour de l’héritage social, parental et de qu’est-ce que c’est la chevalerie au fond ? Mais aussi la dimension où c’est ceux qui ont une identité cachée qui culpabilisent en côtoyant les autres chevaliers qui, eux, sont dans leur bon droit (dans le sens où ils n’ont pas de secret et sont de pure noble naissance : ils sont chevaliers parce qu’ils devaient l’être, c’était prévu), mais qui ne se comportent pas comme des personnes légitimes à porter les valeurs de la chevalerie. Alors que les personnes qui mentent, “paradoxalement” si. C’est vraiment une question autour de la moralité dans tout ça, qui est assez intéressante.
Je pense que c’est aussi un discours qu’on a besoin d’entendre, sur les formes de pouvoir. Même pour résonner avec l’actualité, où les personnes qui sont au pouvoir ne sont pas forcément des personnes qui respectent leurs devoirs. Il ne faut pas que ça devienne un cliché de fiction, c’est sûr, mais ça résonne avec la contemporanéité – et dans ce cas c’est notre époque qui serait cliché, malheureusement…
C’est très intéressant parce que justement le médiévalisme il sert à ça : Il ne dépeint pas tant le Moyen Âge que notre époque ! Et notre époque nous pousse à nous dire « ok, en fait, on a oublié qu’il y avait des guerrières » ; « Ok, en fait, les personnes qui sont au pouvoir ne sont pas forcément des personnes bien même si elles doivent porter des bonnes valeurs. »
C’est très contemporain dans l’écriture, et en même temps, il y a une petite reprise du mythe Robin des bois. C’est un autre caractère médiévaliste où depuis longtemps on des représentations où les suzerains classiques sont les méchants.

Ici c’est très systématique, mais comme le discours est très explicite sur « en fait, ils ne sont pas dignes de la chevalerie » ou « moi, j’avais peur de ne pas l’être, mais je porte mieux les valeurs qu’eux donc je suis légitime »… C’est intéressant parce qu’on est dans une époque de redécouverte de la féodalité, de la chevalerie et de ce que ça implique exactement.
Je pense notamment aux travaux de Gilles Martinez, de Nathanaël Dos Reis qui sont cruciaux par rapport à cette question-là, parce que ça permet de mettre au jour ce que c’est. La chevalerie, ce n’est pas quelque chose de figé, qui s’est créé à un instant T avec ses valeurs. Nathanaël Dos Reis en parlera mieux que moi, mais il évoque notamment un boulanger qui était devenu chevalier pour une raison que je ne divulgâcherai pas, mais on a des contre-exemples comme ça : la réalité est toujours pleine de nuances, quoi qu’il arrive.
Tu as travaillé autour de la blessure en fantasy historique, on imagine ici que les médecins ne peuvent pas faire des miracles pourtant on a l’impression que la pratique de la joute et des combats est très dangereuse ? Comment on représente ça dans la fiction ?
M. K. : Dans Tête de chien, les auteurs font un clair distinguo entre la joute —qui est un jeu— et les escarmouches et les combats qui impliquent de risquer sa vie. Parce que, justement, dans le tournoi, le but n’était pas de tuer son opposant, c’est de le capturer pour se faire de la moula. Ou pour d’autres raisons politiques, pour la gloire, mais l’idée c’était vraiment un jeu, c’est un rituel sportif avec un fort impact culturel. C’est souvent scénarisé, on a même des traces de tournois qui étaient là pour remettre en scène des combats des romans arthuriens. C’est du sport-spectacle, il y a un public et plein d’éléments donc l’idée, ce n’est pas du tout de se blesser, parce que ce serait dommage dans un tel cadre. Certes, on peut s’y blesser, mais c’est quand même limité et ils avaient l’équipement pour éviter ça. Par contre, oui, ils montrent clairement lors des escarmouches que c’est risqué.

Et je trouve que c’est très bien joué justement là-dessus, parce que ça montre que le tournoi est un spectacle, sauf quand on va se retrouver dans une situation où il y a complot et volonté d’éclater l’autre sous couvert d’accidents de tournoi, ce qui était aussi un fait historique. On le voit d’ailleurs chez un autre auteur de fantasy médiévaliste : Jean-Philippe Jaworski avec le Chevalier aux épines ou y a un tournoi dans la fin du T1 avec un accident qui se produit, qui n’en était pas un.
La question de la blessure est hyper intéressante dans le cas des escarmouches : qu’est-ce que ça implique au niveau de l’équipement ? Justement dans le T3 de Tête de chien, le combat entre Tête de chien et Gaucher où il n’a pas son casque et se prend un bon coup de boucliers dans la tête, qui le fait perdre. Au début, en lisant je me dis “il a pas de casque, c’est n’importe quoi” parce que c’est une habitude de la fiction d’ “oublier” les casques, notamment parce qu’on voit plus les acteurices qui sont payés cher pour… qu’on voie leur visage. Et là il ne l’avait pas, mais ça a été utilisé, et c’est intéressant.
Il y a le discours du médecin aussi. Le médecin vétérinaire qui dit que c’est bon, c’est une blessure d’épée, c’est propre, ce n’est pas une dent de sanglier. Et il y a un distinguo qui est fait entre des blessures, les types de blessures, etc. même s’il guérit “un peu” vite, pour les bienfaits de la fiction. Par rapport aux accidents, à la traumatologie, aux études qui ont été faites, certes on peut tenir un combat malgré une blessure, parce que l’adrénaline, parce que ça tient malgré tout , mais ça pouvait endommager très fort, immobiliser pendant des années, etc.. Là, il a eu de la chance sur sa blessure, parce qu’elle est très légère.
Il y a aussi les blasons, les codes héraldiques qui sont des clefs de cette série, est-ce que ça aide à crédibiliser l’ensemble ?

M. K. : Je pense qu’il y a un intérêt double. Ils vont permettre l’incarnation de l’univers et créer le pittoresque dans le sens classique du terme qui est de faire sentir le lieu, faire sentir l’époque. Ils portaient des blasons, les boucliers étaient rutilants. Historiquement, il y avait vraiment une importance très forte de ces éléments.
De plus, on est face à une bande dessinée remplie de personnages : aussi quand on a un doute sur qui est sous le masque, il suffit d’aviser le blason. À ce titre, le scénariste a très bien joué son coup dans les dialogues, en alternant l’usage des prénoms et des surnoms tirés de l’héraldique, ça active ce qui fait que ça crée la mémoire et l’on parvient ainsi à se rappeler de de l’identité des personnages.
En parlant de lectures, tu travailles sur des corpus très différents, est-ce que tu as des conseils pour prolonger celle de Tête de chien ?
M. K. : Je vous conseille la trilogie du Chevalier aux épines de Jean-Philippe Jaworski dont on parlait juste avant, pour la question de la représentation médiévale. Mais l’auteur est très connu chez les lecteurices de fantasy, aussi je vous conseille deux autres titres pour avoir d’autres représentations de la médiévalité.

Avec une petite nuance fantasy, Chien du Heaume de Justine Niogret, un très bon roman, court, très prenant, une ambiance assez incroyable. Ça ne parle pas de tournoi, mais il y a des représentations martiales et ça vous prend aux tripes. Vraiment un de mes coups de cœur.
Et sorti tout récemment La Lance de Peretur de Nicola Griffith, qui est une réécriture du roman de Chrétien de Troyes autour de Perceval avec une volonté de davantage donner du corps historique à l’époque dépeinte. De recontextualiser le temps du roman et en même temps, de faire une écriture queer où Perceval est Peretur, une femme. Donc un autre récit de rôles cachés parce que Peretur ne va pas tout de suite dire que c’est une femme, pour des raisons évidentes. C’est court également et au niveau de la plume et de la traduction, c’est un bijou.
Un grand merci Marie pour cette discussion & ses conseils ! On espère qu’avec ces pistes de réflexion vous ne lirez plus cette série de la même manière et que vous pourrez en parler autour de vous avec quelques anecdotes si vous êtes déjà fans.
Tête de chien de Vincent Brugeas, Ronan Toulhoat & Yoann Guillo, Dargaud (3 volumes parus)
Visuel principal : © Vincent Brugeas / Ronan Toulhoat / Yoann Guillo / Dargaud